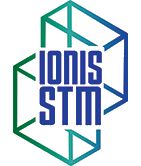Sortie du livre de Ionis-STM « La double compétence : l’antidote à l’obsolescence professionnelle » : découvrez l’entretien de Laure Lucchesi, directrice d’Etalab

Ils sont experts en ressources humaines, dirigeants d’entreprises et d’institutions publiques, top managers, créateurs de startups, spécialistes du monde des médias, de la communication, de la santé ou encore de l’ingénierie : eux, ce sont les 15 co-auteurs de « La double compétence : l’antidote à l’obsolescence professionnelle », le premier livre de Ionis-STM qui paraîtra en janvier 2019 chez FYP Editions. Après la préface signée par le prospectiviste Joël de Rosnay et l’entretien réalisé avec Fred Courant, créateur de L’Esprit Sorcier, l’école vous propose de découvrir un troisième extrait exclusif de cet ouvrage pensé pour permettre à chacun de comprendre l’exigence de transversalité qui s’impose aujourd’hui. Il s’agit de l’entretien réalisé avec Laure Lucchesi, directrice d’Etalab, tiré cette-fois du chapitre « La transformation nécessaire des organisations ».
Diplômée de HEC en 2001, Laure Lucchesi a connu une carrière internationale dans le secteur public et privé autour de projets liés à la transformation digitale et à l’innovation numérique. Elle est devenue directrice d’Etalab en 2016, après avoir rejoint initialement la mission en 2013 en tant que directrice adjointe.

Le défi de la transformation de l’administration
Quand il s’agit d’aborder les questions de flexibilité, de conduite du changement ou de management horizontal, l’administration française n’est pas le premier nom auquel on pense au moment de citer un exemple de référence. Avec sa réputation de structure si grande et labyrinthique qu’elle en devient par moment immobile, voir réfractaire à toute évolution quand bien même cette dernière pourrait être positive, la fonction publique semble parfois ressembler aux vestiges d’un temps révolu, à une sorte de temple sacré impossible à réformer et à transformer. Pourtant, bien obligée d’avancer et de faire siens les nouveaux outils et nouvelles méthodes, les services de l’État ou des collectivités voient leur carapace se fissurer petit à petit sous les soubresauts de l’époque grâce à des initiatives cherchant à faire rimer innovation avec administration. Dirigé par Laure Lucchesi, Etalab fait partie de ces avant-gardes destinées à contaminer par à-coups le mammouth protéiforme et complexe du service public. Créée en 2011 et rattachée à la Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État (DINSIC), cette mission entend non seulement coordonner la politique d’ouverture et de partage des données publiques, mais aussi contribuer à la mise en œuvre des principes de « gouvernement ouvert ». Un objectif annonciateur de bouleversements profonds qui nécessite de faire se rencontrer de multiples compétences. Une manière d’infuser le principe de transversalité jusqu’au cœur même de l’État.
Vous êtes diplômée de HEC Paris, en Marketing, Arts et Culture, promo 2001. HEC n’est pas vraiment réputée pour son ouverture aux nouvelles technologies. Comment êtes-vous venue à personnellement vous intéresser au monde des données et plus généralement à la tech ?
Laure Lucchesi : J’ai choisi de faire une école de commerce, car, à l’époque, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. J’étais très jeune et me disais que faire une formation commerciale, une « prépa » puis HEC m’offrirait le plus d’opportunités derrière en termes de diversité de postes et de fonctions possibles. Aujourd’hui, il y a d’autres façons d’accéder à des postes à responsabilités même quand l’on n’a pas suivi ce type de formation, notamment dans la tech où savoir coder et avoir une compréhension des enjeux sont des atouts extrêmement importants.
Au départ, je n’avais pas ce background technique, car j’étais surtout intéressée par les arts et la culture, et notamment par les arts plastiques. Finalement, après réflexion, j’ai trouvé que travailler dans le milieu de l’audiovisuel et de l’entertainment était une bonne façon d’avoir à la fois la dimension culturelle et du contenu, tout en évoluant dans un milieu beaucoup plus dynamique : au début des années 2000, il y avait déjà énormément d’innovations dues à la technologie dans ce secteur, avec notamment le début de la VOD sur Internet et de la distribution numérique des contenus. J’ai commencé dans ce domaine par des stages en conseil en stratégie, puis suis partie en 2002 aux États-Unis pour rejoindre le service économique de l’Ambassade de France à San Francisco, soit mon premier passage dans le secteur public. C’était une façon idéale de comprendre l’innovation liée aux nouvelles technologies aux États-Unis. Nous étions alors au début de ce que l’on n’appelait pas encore la « disruption numérique » dans une industrie de premier plan, celle du contenu et des médias, touchée de plein fouet par cette révolution. Une expérience vraiment intéressante puisque je couvrais le secteur audiovisuel et des nouveaux médias avec de la veille, des études de marché et de petites missions d’appui et de conseil pour des entreprises françaises souhaitant s’installer à l’étranger. J’étais alors en lien avec tous les grands groupes de communication, les chaînes de télé, les studios et les nouveaux acteurs émergents. Je pense notamment à Netflix : son créateur venait tout juste de se lancer et proposait alors un service d’envoi de DVD par la Poste, mais il imaginait déjà son avenir à travers la distribution de films en ligne.
Forte de cette connaissance, je suis revenue en France en 2004 pour travailler dans de petites structures faisant de la veille et du conseil dans l’audiovisuel français. Cela a duré un temps, avant que l’envie de repartir à l’étranger ne revienne. J’ai alors rejoint le cabinet de conseil en stratégie Capgemini Consulting dans la practice spécialisée télécoms, media et Internet. Cela m’a permis de travailler pour de grands groupes en France et à l’étranger autour de lancements de nouveaux produits et services, mais aussi de diversifications d’activités, toujours dans le domaine du numérique. L’occasion d’aborder les questions des données, de la transformation, de la conduite du changement. C’est lors de mon tout dernier projet chez Capgemini Consulting que j’ai pu rencontrer Henri Verdier, qui allait devenir le directeur d’Etalab. À ce moment-là, je songeais à quitter l’entreprise pour rejoindre une start-up et ainsi passer du conseil pur à la responsabilité stratégique et opérationnelle, avec des circuits de prises de décision courtes et des méthodes agiles. Échanger avec Henri m’a fait changer d’avis : il cherchait une adjointe et m’a présenté Etalab comme une administration atypique qui, à travers les sujets de données et d’open data, allait amorcer une transformation profonde du fonctionnement des services de l’État et des politiques publiques. Voilà comment j’ai intégré Etalab que je dirige aujourd’hui, Henri ayant depuis été appelé à occuper d’autres fonctions (il est désormais ambassadeur pour le numérique, auprès du ministre des Affaires étrangères). Quitte à transformer une organisation, autant le faire pour l’intérêt général et pour le service public.
Qu’est-ce qui vous attire autant dans ce que beaucoup nomment « l’esprit start-up » et que l’on peut retrouver par moment dans le fonctionnement même d’Etalab ?
Ce parallèle entre Etalab et les startups est réel. Il y a des choses que l’on partage avec elles, mais il y a aussi des choses très différentes quand on travaille dans et pour l’État. Ce que nous avons en commun — ou, du moins, ce que nous essayons d’amener —, c’est avant tout des modes d’organisation, de gestion des activités et de gestion des équipes que l’on retrouve dans les startups. Cela se voit jusque dans mon bureau où les post-its sont légion. On met en avant et favorise les modes de travail plus collaboratifs, le fonctionnement en mode projet, le partage de connaissances ou encore le fait de pouvoir travailler en petites équipes agiles.
On essaye également de toujours penser à l’usager ou au bénéficiaire d’une offre ou d’un service public, là où les startups pensent toujours au client. On se centre sur ce point de vue dès le départ avant d’attaquer les questions sous un angle politique, juridique ou systémique : on part d’abord d’un besoin très précis et on colle à cette expérience utilisateur spécifique en travaillant de façon itérative, agile et collaborative. C’est assez nouveau dans la façon de développer des produits et services numériques, mais aussi dans la manière de travailler des administrations. Ces dernières ont plutôt des modes de travail plus classiques, avec des chaînes de décision pyramidales. Chez Etalab, on préfère ainsi faire confiance à nos équipes. Elles connaissent leurs responsabilités et savent que développer une fonctionnalité n’est pas anodin. On aime souvent à interpréter à notre façon la phrase « Code is law » de Lawrence Lessig : en effet, on sait bien que les techniciens, développeurs et data scientists embarquent plein de choix stratégiques lorsqu’ils développent une nouvelle fonctionnalité dans un produit ou service. Si l’on crée un site web ou une fonctionnalité, la façon dont elle est mise en œuvre intègre plein de décisions stratégiques et de transferts de responsabilités.
Un bon exemple, c’est le premier projet sur lequel nous avons travaillé, à savoir la reconstruction du site data.gouv.fr, la plateforme des données partagées par l’administration. Avant l’arrivée d’Henri et moi à Etalab, sa création avait été externalisée. Nous voulions la redévelopper en intégrant de nouveaux principes. Pour nous, data.gouv.fr ne devait pas seulement être la plateforme des données de l’administration : elle devait aussi devenir une plateforme ouverte à tous les contributeurs volontaires souhaitant y partager des données d’intérêt général. Pour arriver à cela, il faut de la fluidité et ne pas passer par quinze chaînes de décision, avec un agent du service public qui doit demander la permission à sa hiérarchie de partager ses données sur la plateforme. Il a donc fallu inverser le fonctionnement, y compris dans le design même du produit. Le partage des données est ainsi devenu plus facile, la modération se faisant ensuite a posteriori : si la communauté utilisatrice estime que certains jeux de données n’ont rien à faire dessus, ils sont retirés. En faisant cela, on avait conscience de changer également profondément la politique publique d’open data. La plateforme héberge des données des ministères, mais aussi des données d’entreprises et d’associations. Cette « culture start-up » se retrouve aussi dans notre approche collaborative du travail. Chez Etalab, nous n’avons pas de fiches de poste cloisonnées.
Un autre point essentiel que nous avons su adapter à Etalab, c’est l’expérimentation et le test… tout en acceptant que l’on peut se tromper ! Un bon exemple, c’est le cas de l’incubateur de startups numériques qui développe des services numériques sous le format « Startups d’État ». Et bien certains peuvent échouer pour différentes raisons — nous n’avions pas bien aligné les bons acteurs, il y a eu des problèmes de passation, le service n’a pas trouvé son public, etc. L’erreur peut arriver. Il y a donc des choses que l’on partage dans l’agilité, la façon de travailler, la prise de risques, l’expérimentation perpétuelle et la réflexion autour des utilisateurs et usagers.
À la différence des startups, nous n’avons pas l’opportunité de choisir le client que nous voulons servir. En tant qu’administration de l’État, nous avons des obligations d’assurer une continuité du service public et une égalité de tous les usagers-citoyens vis-à-vis de lui. Nous ne pouvons pas nous permettre de décider de ne pas servir tel ou tel segment de la population. Un membre de l’équipe a récemment utilisé une image qui résume très bien cela : nous sommes comme dans un logiciel où se trouvent des branches instables et des branches stables. Nous nous autorisons des zones où expérimenter par nous-mêmes et être « instables » : il y a des sujets où l’on se doit d’être un peu pionnier, de défricher, pour gagner en connaissances et en pertinence. Et puis au fur et à mesure, nous réintégrons ce savoir acquis dans notre cœur d’activité, dans notre rôle d’organisation qui fournit des services publics.
C’est un travail d’équilibriste.
Oui. Mais c’est un travail nécessaire. C’est ainsi que nous concevons notre rôle, celui d’Etalab : nous défrichons certains sujets et sommes là pour faciliter l’adoption des innovations dans les autres administrations. Aujourd’hui, les ministères sont financés avec de l’argent public dépensé avec beaucoup d’attention et ces budgets leur permettent tout juste de mener leurs missions traditionnelles. A contrario, ils ont parfois du mal à dégager des ressources financières, du temps d’agents disponibles ou simplement des capacités en interne pour gérer des nouveaux projets autour de la donnée et du numérique. C’est là qu’Etalab intervient : nous mettons à disposition des outils utiles à tous, et nous aidons ponctuellement les ministères à dégager un peu de ressources et de temps pour innover, mais aussi de la « disponibilité d’esprit ». Par ce point, j’entends : faire sortir les agents de leurs bureaux pour les amener à travailler de façons différentes et à aller au contact de la société civile pour justement entretenir chez eux et développer cette capacité d’innovation. Même si une partie de la dépense publique tient de plus en plus compte des questions autour de la donnée et de la transformation numérique, cela reste une mission assez difficile, car il est normal que tel ou tel ministère pense d’abord à utiliser ce budget pour mener à bien ses missions principales.
Quels sont vos moyens pour mettre en œuvre ces chantiers ?
Les ressources financières et humaines d’Etalab sont limitées — nous sommes une quinzaine et notre budget annuel est d’environ 1,6 million d’euros — et, pour mener à bien notre mission interministérielle, nous combinons plusieurs modes d’action : l’autorité, l’accompagnement et la mise à disposition d’outils. Parfois, sur certains sujets, nous incarnons l’autorité du Premier ministre. Quand nous travaillons avec les ministères, nous sommes ainsi amenés à écrire des choses dans la loi ou donner des directives. C’est ce qu’on appelle chez nous le « Legal Way ». L’accompagnement des agents, pour les guider dans la transformation, c’est le « People Way » : on est animateur de communautés, on leur facilite la tâche en leur apportant des ressources, soit par la venue de nos équipes chez eux, soit par la mise en place de guides pratiques. Enfin, le dernier moyen d’action, c’est le « Maker Way ». Il s’agit de développer des outils et des logiciels par nous-mêmes, pour ensuite accompagner les ministères sur ces outils. Au fond, nous sommes aussi bien capables d’écrire des textes de loi que d’expliquer — à travers des ateliers, des hackathons, des data camps ou même des séances de « data-touilles » où l’on s’assoit à côté des administrations pour les aider à comprendre ce qu’il y a dans leurs données ! — et de créer nous-mêmes des produits, plateformes et services numériques.
Ces méthodes sont également appliquées au sein de l’incubateur beta.gouv. Un bon exemple, c’est le Pass Culture annoncé par le président de la République et qui consiste à donner 500 euros aux jeunes pour découvrir la culture. Il aurait pu être fait de manière traditionnelle, mais on a préféré le réfléchir en mode Start-up d’État : on va aligner plein d’acteurs sur un produit pour ensuite soulever différentes questions, faire des choix en conséquence ou plutôt des arbitrages et élargir l’offre. C’est une approche itérative, avec des expérimentations réalisées sur cinq territoires. Si l’on avait attaqué la chose par le principe, on aurait pu se perdre sur des questions très systémiques — c’est quoi la culture ? Est-ce que tel ou tel domaine en fait partie ? Etc. En passant par cette démarche, en rentrant autour d’un produit, cela change la façon dont les gens et les partenaires interagissent et discutent. C’est un profond changement culturel.
Comment définiriez finalement la mission d’Etalab ?
Il y a plein de façons de la décrire. C’est très mouvant et, au sein de l’équipe, on réfléchit régulièrement à comment bien la raconter. Historiquement, Etalab est la mission du Premier ministre chargée d’ouvrir les données publiques. Ça, c’était en 2011. Depuis, on est allé bien au-delà, car on s’est aperçus qu’entrer par la donnée soulevait énormément de questions menant à la transformation numérique profonde de l’administration publique.
Notre action évolue en permanence : on a commencé par l’open data, puis on est allé vers la politique de la donnée dans l’État, qui permet de prendre de meilleures décisions grâce aux données et de se diriger vers une gouvernance de la donnée dans l’administration. On s’est ensuite penché sur le machine learning, les algorithmes et maintenant l’intelligence artificielle. Mais nous sommes allés sur tous ces sujets par le terrain, pas simplement par mandat. C’est ce qui fait que l’on retrouve un certain côté intrapreneurial-entrepreneurial chez Etalab : en partant d’une mission initiale, nous sommes allés chercher des ressources pour développer des sujets et programmes en interne et ensuite les porter. Ce sont, en majorité, de profonds facteurs de transformation. Je pense notamment au programme « Entrepreneur.e d’intérêt général » lancé en 2016 et né suite à des échanges avec les équipes de Barack Obama. En effet, la Maison-Blanche avait créé le programme « Presidential Innovation Fellows » pour faire venir de l’extérieur des développeurs et data scientists pour relever des défis, collaborer et mener des projets numériques dans l’administration. Chez Etalab, on cultive ce lien avec nos homologues internationaux. Il y a une forte émulation avec d’autres pays. Bref, en faisant au fur et à mesure, on a eu plein de nouvelles idées que l’on a mises en œuvre. De ce fait, si je devais définir Etalab en une phrase, je dirais que nous sommes une espèce d’agence d’innovation radicale dans l’administration, à la fois défricheur et expérimentateur pour donner lieu à des innovations vouées à se pérenniser, mais aussi capables de créer un effet d’entraînement pour avoir un impact plus large et réel au-delà d’une petite communauté d’innovateurs.
Faire de la recherche pour de la recherche, ce n’est pas votre mantra.
Exactement, notre action doit être appliquée. Nous ne sommes pas non plus des « super geeks » qui fonctionnent en mode commando : si l’innovation que nous proposons n’est pas capable de se diffuser, d’être comprise, appréhendée et appropriée par les agents des services publics partout sur le territoire, c’est raté. On teste, on regarde et on sélectionne ce qui a vocation à se diffuser. Il faut toujours rester vigilant pour que ce que l’on fait ne reste pas dans un coin et ne parle qu’à une communauté d’experts. C’est l’une des principales difficultés auxquelles est confronté Etalab.

Votre rôle en tant que directrice est de veiller à cela ?
Avant tout, il consiste à faire en sorte que les membres de l’équipe aient justement cette capacité à pouvoir innover et expérimenter au quotidien de leur donner le plus de ressources possibles et de facilité d’action. C’est beaucoup de boulot, car nous restons dans un environnement administratif. Le fonctionnement de l’administration traditionnelle, la coordination avec les ministères… Tout cela impose certaines contraintes. Cela passe aussi par des détails comme, par exemple, le matériel informatique : d’ordinaire, ce matériel est le même dans toutes les administrations, suivant des règles légitimes. À Etalab, nous nous devions d’avoir un autre équipement, d’être en capacité de déployer un serveur et d’installer des logiciels pour les tester… C’est une partie de mon rôle de directrice de la mission d’aller expliquer que ces besoins sont justifiés et d’apporter à mon équipe les bonnes conditions pour qu’ils puissent apporter à l’État ce pour quoi il les a recrutés. L’autre partie du rôle est évidemment d’assurer la bonne tenue et l’avancée des missions et mandats qui nous sont donnés par le Gouvernement, le Premier ministre et le Secrétaire d’État chargé du numérique. Cela demande un travail de synchronisation avec les ministères, et je suis également amenée à faire le lien avec les différentes autorités de l’État sur certains chantiers, du Gouvernement à l’Élysée. Enfin, la dernière composante concerne les relations extérieures. Je représente Etalab dans des événements internationaux, des conférences… mais j’attache beaucoup d’importance au fait que tous les membres de l’équipe puissent le faire aussi ! Pour moi, il est crucial que chacun ait la possibilité d’aller expliquer son métier et ce qu’il fait ailleurs que dans le cadre étatique. Il y a un véritable enjeu à être capable de raconter nos missions. Il y a par ailleurs quelque chose de très précieux et d’important chez Etalab, que l’on veut absolument maintenir et cultiver : l’interdisciplinarité, la pluralité et la diversité de compétences et de profils. Nous n’avons pas que des statisticiens, des juristes ou des experts d’une politique publique : notre équipe compte des personnes qui, bien que sans diplôme, sont des expertes sur un sujet ou dans un domaine de données particulier, des diplômés en sciences politiques ayant décidé de se former au langage Python sur leur temps libre, des juristes codeurs, etc. Nous mélangeons des gens ayant des compétences multiples, en sciences humaines, sciences dures, informatique, statistiques, droit…
Justement, en France, tous les citoyens ne sont pas digital natives, y compris dans l’administration. Comment faire pour arriver à les fédérer et surtout réussir à leur faire comprendre ce que vous faites ? La question semble légitime, car, finalement, il est assez rare d’entendre parler d’Etalab dans les médias grand public.
Il est vrai que notre travail se fait énormément en back-office et que la conduite du changement au sein de l’administration n’intéresse pas forcément le journal de 20 h. En revanche, montrer les changements concrets que permet Etalab est bien plus simple. Quand, via le programme « Entrepreneur.e d’intérêt général », on fait venir des gens de l’extérieur pour relever un défi et travailler sur un service dans une administration, cela engendre automatiquement une transformation en interne de la structure concernée. Les agents publics se confrontent à de nouvelles façons de travailler, échangent avec ces mentors, décident d’ouvrir des données, de partager du code source… C’est une autre forme de communication et cela conduit à une meilleure compréhension de notre mission et de l’enjeu de l’open data.
En parlant de jeunes développeurs attirés par le service public, vous avez refusé des propositions de Google et Facebook afin de rejoindre Etalab. Pourquoi avoir fait ce choix ? Pour innover là où il n’y avait pas d’innovation ?
Ce qui m’importe, c’est de servir l’intérêt général, de transformer la puissance publique au sens large et donc, par ricochet, la vie des Français. Aussi petite qu’elle soit, ma contribution à cette révolution numérique peut avoir de l’impact. J’ai aussi conscience de ça. Il y a tellement de choses à faire et l’on n’est jamais assez nombreux pour prendre part à ce chantier. Bien évidemment, Google et Facebook restent des lieux très intéressants où il se passe énormément de choses, où tout va très vite et où les moyens financiers sont importants. Ces deux acteurs ont un impact certain sur l’évolution du numérique. Cela pose d’ailleurs des questions d’influence — il y a probablement chez eux des innovations en cours qui seront amenées à changer le monde à l’avenir. À ce titre, l’État ne doit pas être en retard sur ces nouveaux sujets : il doit se poser les bonnes questions et les anticiper suffisamment à l’avance. C’est le cas avec l’intelligence artificielle, qui va bouleverser la société, le travail… Les décideurs publics doivent être en mesure de mieux comprendre les enjeux qui en découleront. Le défi de porter ces questions au plus haut niveau de l’État m’intéressait aussi. Ce qu’Etalab fait est passionnant, pas toujours simple certes, mais profondément stimulant. Attirer des talents pour venir travailler dans l’État, ce qui n’est pas toujours intuitif pour des jeunes diplômés à la sortie de leur école, est un challenge. Voir que des participants à nos actions souhaitent rester dans l’administration par la suite, c’est une énorme satisfaction.
Que pensez-vous du rapport du député et mathématicien Cédric Villani remis à ce sujet ?
La définition de l’IA a changé ces dernières années. Derrière elle, il y a un spectre très large. Par exemple, au sein d’Etalab, nous appelions encore data science en 2017 des choses qui, aujourd’hui, sont nommées IA. On peut faire des choses assez simples qui auront un fort impact avec une faible quantité de données et un bon algorithme. Toutefois, ce changement a du bon selon moi. Regrouper dans l’IA des termes plutôt techniques comme data science ou l’apprentissage automatique, cela facilite sa compréhension et une réelle prise de conscience des questions que cette évolution pose et de ce qu’il est possible de faire avec. C’est un atout indéniable en matière de pédagogie. Ce qui a été fait avec le gouvernement précédent autour de l’IA a préfiguré un certain nombre de mesures. Avec les travaux de Cédric Villani, qui a d’ailleurs ce côté très pédagogue et médiatique idéal pour aider à mieux comprendre ces questions, on va encore plus loin. Les récentes informations sorties dans la presse, parfois désastreuses, car impliquant des IA défectueuses ou des scandales de données, ont aussi servi à ouvrir et nourrir la discussion, à mettre ce sujet sur le devant de la scène. Le rapport de Cédric Villani préconise justement que l’Etat se saisisse du sujet, en commençant éventuellement par la réalisation de petits projets avant d’aller vers des actions de plus grande envergure. Etalab a été ainsi choisi pour abriter le « lab » de l’intelligence artificielle de la France. Ce ne sera pas un pur labo de recherche, qui réunira uniquement les meilleurs experts techniques : ce sera un laboratoire complet de transformation publique, on y trouvera aussi des gens ayant des compétences en sciences humaines, des spécialistes de la conduite du changement. Ce choix de faire appel à Etalab est logique de par notre expérience et notre rôle auprès des différents ministères, mais ce n’est qu’une première étape. Que les choses avancent dans la sphère publique, c’est bien, mais il faut également réfléchir avec le secteur privé à comment créer des clusters ou des hubs de données afin de partager de la data de qualité et pleinement l’exploiter. Cette politique de l’IA est aussi source de compétitivité et d’attractivité. Prenons le cas de la santé par exemple, justement abordée dans le rapport : avec son système très centralisé, la France peut se targuer de posséder l’une des bases de données les plus riches au monde en santé. Reste à savoir comment l’exploiter ? Avec quelles technologies ? Avec quels droits d’accès sachant qu’il convient de conserver une certaine confidentialité ? Quelles vont pouvoir être les zones d’ouverture ? Pour quelle finalité ? Comment va-t-on améliorer la santé des Français à la fin ? Ces questions ne doivent pas être ignorées par la puissance publique d’autant que l’IA va peut-être produire des effets plus vite que prévu. Réfléchir à ces questions est important, mais cela l’est tout autant de commencer à expérimenter sur des applications concrètes, même petites.
Se rapprocher du secteur privé est-il essentiel ?
Être très ouvert sur la société civile est l’une des raisons d’être d’Etalab. C’est ce qu’on appelle parfois l’open government où comment associer les citoyens, la société civile et les associations à la décision publique. Les entreprises font aussi partie de cette société civile, elles sont les plus grands producteurs et utilisateurs de données…
Il est ainsi particulièrement important d’avoir des modes de gouvernance ouverts sur toutes les questions éthiques qui vont se poser autour de l’IA par exemple, notamment en rapport avec la transparence des algorithmes, pour être en mesure de mettre des garde-fous là où il faudra en mettre. Comme il s’agit d’une question concernant tous les français, elle doit être posée de manière collective. Ces interactions sont donc essentielles. L’individu affecté par tel ou tel algorithme doit être en mesure de demander des comptes à l’administration afin de savoir pourquoi telle décision a été prise à son égard. Il faut définir des zones d’ouverture et de transparence, y compris sur des sujets techniques. Là encore, Etalab a un rôle à jouer. Cela revient à redonner, grâce au numérique, du pouvoir aux usagers et aux citoyens, oui. L’administration doit rendre des comptes sur ses actions. On ne peut pas utiliser de boîte noire : les fondamentaux de la prise de décision sont censés être compris par tous.
Dans un monde qui n’arrête pas de changer, comment faites-vous pour rester à la page ?
Cela passe d’abord par le fait d’être ouvert, de sortir, d’aller au contact de l’extérieur. Nous ne sommes pas des agents publics enfermés dans leurs bureaux : à travers les ateliers, les hackathons ou encore les meetups auxquels nous participons, nous sommes en permanence en prise avec des talents présents en dehors de l’administration. Nous allons à la rencontre de l’innovation. Cela se traduit également par le développement : en façonnant des logiciels open source, on démarre une relation d’échanges avec une ou plusieurs communautés. Cette ouverture passe aussi à une échelle plus macro, via les liens établis avec nos homologues étrangers, que ce soit les services de la Maison-Blanche, le Government Digital Service au Royaume-Uni ou des pays moins « connus » sur ces questions, mais où se trouvent de très intéressantes innovations. Certaines nations ayant des administrations plus récentes que la nôtre, elles avancent parfois plus vite en sautant des étapes et prenant des raccourcis. Cet échange entre pairs est fondamental pour le développement des logiciels et des data sciences. Enfin, pour rester à la page, il convient encore et toujours d’expérimenter ! Parfois, certaines nouvelles technologies font le buzz avant de retomber dans l’oubli. Les suivre et les expérimenter permet de se forger sa propre opinion sur leur utilité réelle. Grâce à cette philosophie, Etalab est en mesure de pouvoir faire le tri entre les idées en vogue pour un temps donné et celles qui ont vocation à durer.
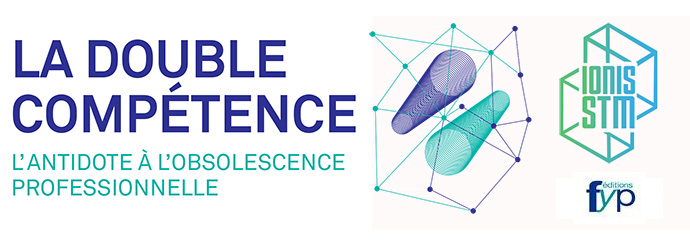
Sortie officielle de l’ouvrage le 2 janvier 2019 :
Les précommandes sont déjà possibles via le site de FYP Editions